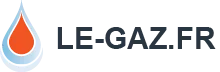Privée du gaz russe, l’Europe redéfinit sa stratégie énergétique. Entre diversification, souveraineté et transition, les enjeux sont colossaux.
L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a marqué un tournant brutal pour l’approvisionnement en gaz de l’Europe. Dépendants à près de 40 % du gaz russe avant le conflit, les États membres de l’Union européenne ont été contraints de repenser en urgence leurs sources d’énergie. Plus qu’un simple réajustement commercial, cette crise énergétique soulève des questions fondamentales de souveraineté, de sécurité et d’avenir énergétique. La géopolitique du gaz est désormais au cœur du débat européen.
La fin d’une dépendance structurelle
Pendant des décennies, le gaz russe a été un pilier de l’approvisionnement énergétique européen. Acheminé par d’immenses gazoducs tels que Nord Stream ou Yamal-Europe, il était bon marché, abondant, et servait d’appui à l’industrie, au chauffage et à la production d’électricité. Cette dépendance, construite sur des décennies, reposait sur l’idée d’un partenariat stratégique stable entre Moscou et l’Europe.
La guerre en Ukraine a pulvérisé cette certitude. Dès les premiers mois du conflit, la Russie a réduit, puis quasiment interrompu ses livraisons vers l’UE, utilisant le gaz comme une arme de chantage géopolitique. Les prix se sont envolés, les tensions se sont accrues, et les États membres ont dû réagir rapidement pour éviter un effondrement énergétique.
Diversification tous azimuts
Face à l’urgence, l’Union européenne a déployé une stratégie de diversification sans précédent. Le recours au gaz naturel liquéfié (GNL), transporté par navires depuis les États-Unis, le Qatar, le Nigeria ou encore l’Algérie, a explosé. En 2023, les importations de GNL ont représenté près de 50 % de l’approvisionnement gazier de l’UE, contre 20 % avant la guerre.
De nouveaux terminaux méthaniers ont été construits en un temps record, notamment en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas. La Pologne, la Lituanie et la Finlande, historiquement dépendantes du gaz russe, ont accéléré leurs connexions avec les réseaux européens et les terminaux GNL. Ce bouleversement logistique s’est fait au prix fort : les coûts ont augmenté, les infrastructures ont été saturées, et la concurrence mondiale sur le GNL a provoqué des tensions avec les pays en développement.
Une souveraineté énergétique à rebâtir
Cette crise a mis en lumière une vulnérabilité stratégique majeure. Dépendre d’un fournisseur unique, en particulier autoritaire et instable, expose l’Europe à des pressions politiques inacceptables. L’objectif est désormais clair : construire une souveraineté énergétique fondée sur la résilience, la diversité des sources, et la maîtrise technologique.
Cela passe aussi par une coopération renforcée entre États membres. Le mécanisme d’achat conjoint de gaz, initié par la Commission européenne, vise à mutualiser les négociations pour sécuriser de meilleurs contrats. Les interconnexions entre pays sont également renforcées pour permettre des transferts d’énergie plus souples en cas de crise.
Mais cette souveraineté passe aussi par la réduction de la consommation globale de gaz. C’est le pari du plan REPowerEU : sobriété énergétique, électrification, développement du biogaz et de l’hydrogène vert sont les piliers de cette stratégie ambitieuse.
Les tensions Nord-Sud et les nouveaux équilibres
En se tournant vers d’autres fournisseurs, l’Europe bouleverse les équilibres géopolitiques du gaz. Le Qatar et les États-Unis s’imposent comme les nouveaux partenaires stratégiques. L’Algérie renforce ses liens avec l’Italie et l’Espagne. Mais cette redirection des flux crée aussi de nouvelles dépendances, cette fois vis-à-vis de puissances éloignées, parfois elles aussi instables ou en tension avec les valeurs européennes.
De plus, certains pays du Sud, notamment en Afrique, dénoncent une « razzia » européenne sur les ressources gazières, qui freine leur propre accès à l’énergie. Le GNL détourné vers l’Europe a parfois provoqué des pénuries ou des hausses de prix en Asie et en Afrique. La solidarité énergétique, dans un monde interconnecté, reste un défi de taille.
Entre urgence et transition, un cap difficile à tenir
La guerre du gaz a rappelé une vérité simple : aucune transition énergétique ne peut ignorer la géopolitique. En cherchant à sortir de la dépendance russe, l’Europe a dû prendre des décisions rapides, parfois contradictoires avec ses engagements climatiques. Relancer les importations de GNL ou signer des contrats à long terme avec des producteurs fossiles reste difficilement conciliable avec l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050.
Pour sortir de cette impasse, l’Europe doit accélérer la transformation de son système énergétique. Cela implique des investissements massifs dans les renouvelables, le stockage d’énergie, les réseaux intelligents et l’efficacité énergétique. Le gaz ne peut plus être qu’une solution transitoire, au service d’un système en mutation rapide.
Le gaz, révélateur de l’Europe politique
Au fond, la crise du gaz est un révélateur de la capacité politique de l’Union européenne à réagir, s’unir et anticiper. Si elle a su éviter le pire en 2022-2023, la question reste entière : saura-t-elle construire une vision à long terme, cohérente, juste et durable ? L’indépendance énergétique, la lutte contre le changement climatique et la solidarité internationale sont désormais des combats indissociables. Et l’Europe, à travers le prisme du gaz, se retrouve à l’épreuve de sa propre ambition.