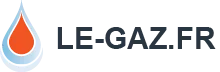Entre ambitions climatiques et réalités économiques, l’industrie gazière cherche sa place dans le monde bas carbone.
Le gaz naturel, longtemps perçu comme une énergie fossile moins polluante que le charbon ou le pétrole, est aujourd’hui à la croisée des chemins. Dans un contexte de crise énergétique et de transition écologique, son rôle est plus que jamais débattu. Alors que certains y voient un allié temporaire vers la neutralité carbone, d’autres estiment qu’il doit lui aussi être progressivement abandonné. Le secteur, de son côté, tente une mue technologique et stratégique pour survivre à cette nouvelle ère.
Une énergie en sursis dans les objectifs climatiques
Depuis les Accords de Paris en 2015, la pression s’est intensifiée sur toutes les énergies fossiles, gaz compris. Pourtant, le gaz naturel est souvent présenté comme un « moindre mal » : il émet environ 50 % de CO₂ en moins que le charbon pour produire de l’électricité. C’est ce qui a justifié, ces dernières années, sa montée en puissance dans plusieurs pays, notamment en Europe pour remplacer les centrales à charbon.
Mais cette image avantageuse est de plus en plus remise en cause. Le gaz reste un combustible fossile, donc incompatible avec les ambitions de neutralité carbone à l’horizon 2050. Pire, les fuites de méthane — un gaz à effet de serre bien plus puissant que le CO₂ — tout au long de la chaîne de production et de transport posent un réel problème environnemental. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), 82 millions de tonnes de méthane ont été rejetées en 2022 par l’industrie fossile, dont une large part provient du gaz.
Le choc de la guerre en Ukraine : accélérateur ou frein ?
La guerre en Ukraine a bouleversé les équilibres du marché du gaz. L’Europe, qui dépendait à hauteur de 40 % du gaz russe avant le conflit, a dû réagir dans l’urgence. Résultat : explosion des prix, inflation, mais aussi diversification des sources d’approvisionnement. Le gaz naturel liquéfié (GNL), importé notamment des États-Unis et du Qatar, a pris le relais, au prix de contrats coûteux et d’une forte dépendance aux marchés mondiaux.
Paradoxalement, cette crise a servi de levier pour certaines politiques de transition. L’Union européenne a lancé le plan REPowerEU pour réduire de deux tiers sa dépendance au gaz russe d’ici 2025, misant sur les économies d’énergie, l’électrification, et les gaz renouvelables. Mais à court terme, la relance de certaines centrales au charbon pour compenser le manque de gaz illustre aussi les contradictions de la période.
Une industrie qui tente de se verdir
Face aux critiques et à la pression réglementaire, les grands acteurs du gaz multiplient les initiatives pour verdir leur image. Le développement du biométhane, issu de la fermentation de déchets organiques, s’accélère en Europe, avec des objectifs ambitieux : en France, GRDF veut connecter 20 % de gaz vert dans son réseau d’ici 2030. Le gaz synthétique, produit à partir d’hydrogène et de CO₂ capté, fait aussi l’objet de démonstrateurs, bien qu’encore peu mature.
Autre piste : la capture et le stockage du carbone (CCS), qui permettrait de continuer à exploiter le gaz tout en neutralisant ses émissions. Des projets comme Northern Lights (Norvège) ou Porthos (Pays-Bas) visent à stocker le CO₂ dans d’anciens gisements sous-marins. Mais ces technologies restent coûteuses et font débat : ne risquent-elles pas de prolonger artificiellement la durée de vie des énergies fossiles ?
Une place résiduelle dans le mix de demain
Dans les scénarios bas carbone établis par RTE ou l’AIE, le gaz conserve une place marginale mais stratégique dans les décennies à venir. Il pourrait servir de solution de secours en cas de pics de consommation, ou d’appoint pour stabiliser les réseaux électriques fortement alimentés par les renouvelables. Cette fonction de « back-up » repose sur des infrastructures existantes et une grande réactivité, mais elle suppose de limiter drastiquement les volumes utilisés.
Les gouvernements, de leur côté, adaptent leur législation. En France, les chaudières à gaz sont progressivement bannies des constructions neuves. En Allemagne, un compromis controversé prévoit l’arrêt des équipements 100 % fossiles à partir de 2024. La trajectoire est claire : l’avenir énergétique européen sera moins gazeux.
Un tournant à ne pas manquer
L’industrie du gaz est aujourd’hui face à un dilemme historique : résister au changement au risque de devenir obsolète, ou s’adapter et se réinventer. Les signaux envoyés par les politiques climatiques, les investisseurs et les consommateurs ne laissent guère de doute. La transition est en marche, et le gaz devra prouver qu’il peut y participer activement.
Pour réussir cette mutation, il faudra des investissements massifs, des innovations techniques, et surtout un cadre réglementaire cohérent. Le gaz naturel n’est plus l’énergie du futur, mais il peut encore être celle de la transition, à condition de savoir quand et comment tirer sa révérence.